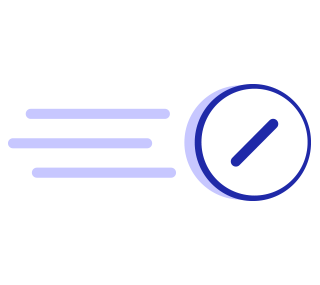Agir en toute transparence par le dialogue et l'ouverture
Le dialogue et le partage de l’information avec les professionnels de santé, les patients et plus largement le grand public, sont au cœur des missions de l’ANSM. Nous travaillons en lien étroit avec l’ensemble de nos parties prenantes, en concertation avec les patients et les professionnels afin que notre action réponde aux enjeux auxquels ils font face.
Nous nous impliquons par ailleurs fortement dans les travaux européens et internationaux afin de porter l’expertise et la position de la France lors des réflexions et décisions prises à ces niveaux. Cette collaboration européenne et internationale est en effet indispensable pour assurer aux patients l’accès à des médicaments et des dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro de qualité, sûrs et efficaces, indépendamment de leur lieu de fabrication et de leur procédure d’autorisation.


Nous nous impliquons par ailleurs fortement dans les travaux européens et internationaux afin de porter l’expertise et la position de la France lors des réflexions et décisions prises à ces niveaux. Cette collaboration européenne et internationale est en effet indispensable pour assurer aux patients l’accès à des médicaments et des dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro de qualité, sûrs et efficaces, indépendamment de leur lieu de fabrication et de leur procédure d’autorisation.
Regards sur… Un leadership international crucial pour innover au service des patients français
En 2022, la présidence française du Conseil de l’Union européenne a permis à l’ANSM de réaffirmer son rôle moteur au sein de l’Europe du médicament et ainsi renforcer l’accès des Français à l’innovation. En complément de son implication au niveau européen, l’Agence partage également son expertise ailleurs dans le monde, comme au Rwanda. Retour sur les enjeux et les perspectives du positionnement de l’ANSM hors de nos frontières avec Pierre Démolis, conseiller scientifique, et Valérie Denux, directrice Europe et innovation.
Pierre Démolis
Conseiller scientifique à l'ANSM

Valérie Denux
Directrice Europe et innovation de l’ANSM
Pourquoi la collaboration européenne et internationale est importante ?
Pierre Démolis : La vie des patients français est directement impactée par les décisions prises à l’échelle européenne, car c’est à ce niveau réglementaire que des médicaments innovants et/ou utiles sont mis à disposition dans les meilleures conditions possibles, ou bien au contraire interdits de mise sur le marché. Ces décisions sont le fruit de travaux et d’échanges menés sur les dossiers instruits par les 27 agences nationales, fédérées au sein de l’Agence européenne du médicament (EMA) qui organise débats et comités, et présente les opinions produites à la Commission européenne. Il est de notre intérêt d’apporter à l’EMA la contribution qui est attendue compte tenu de notre taille, de notre ancienneté et du manque de moyens d’autres pays. C’est également important que notre voix soit entendue à travers l’EMA, comme lors de nos échanges sur les médicaments et les dispositifs médicaux avec l’Agence américaine (FDA), ainsi qu’avec des pays sud-américains ou africains qui sont à l’écoute de propositions européennes.
Valérie Denux : La France a toujours été contributrice aux travaux européens et plus particulièrement à ceux de l’EMA depuis sa mise en place en 1995. Cette contribution s’est faite cependant avec plus ou moins d’implication. Aujourd’hui, il existe une véritable volonté française de se positionner fortement au niveau européen notamment pour ce qui concerne les produits de santé. La crise Covid a évidemment été motrice dans cette dynamique de mise en commun mais elle est aussi devenue indispensable face à des crises multifactorielles, des pénuries récurrentes ou plus particulièrement dans le domaine de l’innovation face à des technologies de plus en plus complexes. C’est pourquoi la participation à la construction d’une « Europe de la santé » est devenue un enjeu majeur pour notre pays. Nous avons, de plus, dans un contexte de nouvelles pandémies potentielles et face à la mondialisation des productions, tout intérêt à construire un certain niveau d’harmonisation et de collaborations avec les autres continents.
Valérie Denux : La France a toujours été contributrice aux travaux européens et plus particulièrement à ceux de l’EMA depuis sa mise en place en 1995. Cette contribution s’est faite cependant avec plus ou moins d’implication. Aujourd’hui, il existe une véritable volonté française de se positionner fortement au niveau européen notamment pour ce qui concerne les produits de santé. La crise Covid a évidemment été motrice dans cette dynamique de mise en commun mais elle est aussi devenue indispensable face à des crises multifactorielles, des pénuries récurrentes ou plus particulièrement dans le domaine de l’innovation face à des technologies de plus en plus complexes. C’est pourquoi la participation à la construction d’une « Europe de la santé » est devenue un enjeu majeur pour notre pays. Nous avons, de plus, dans un contexte de nouvelles pandémies potentielles et face à la mondialisation des productions, tout intérêt à construire un certain niveau d’harmonisation et de collaborations avec les autres continents.
Quelle est aujourd’hui la place de l’ANSM en Europe ?
P. D. : Le manque de ressources de l’Agence au début des années 2000 nous a fait connaître un léger déclin sur la scène européenne. Consciente de l’importance de renforcer la présence de l’ANSM à cette échelle, notre direction générale a obtenu les financements permettant, grâce à des recrutements, de créer au sein de l’Agence une structure dédiée à l’évaluation européenne, qui travaille en lien étroit avec le reste de l’Agence sur les dossiers européens. Ainsi, depuis 5 ans, nous avons retrouvé un leadership au sein de l’Europe à la mesure de notre envergure, et au bénéfice des citoyens français comme européens. Notre retour en première ligne est particulièrement bienvenu, au moment où l’EMA doit s’adapter au départ de la Grande-Bretagne lié au Brexit.
Quel était l’enjeu de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE), temps fort de 2022 pour l’Agence ?
P. D. : Au-delà de nous donner l’occasion de mieux connaitre et de mieux nous faire connaître de nos homologues des autres agences, de faire valoir notre expérience, nos domaines d’expertise et au-delà aussi de l’organisation de 20 réunions , l’enjeu était double. D’une part, avoir une voix forte quant au choix global des thèmes de ces réunions, d’autre part, montrer notre intérêt et lancer une thématique importante pour nous, mise en œuvre sur 18 mois. Nous avons pleinement saisi cette opportunité de faire avancer nos sujets et entendre notre voix.
V. D. : Travailler en amont à son organisation et vivre pendant six mois au rythme d’une présidence, avec tous les échanges informels qu’elle implique, permet d’aborder les sujets autrement ou en aborder de nouveaux. Cela ouvre la réflexion. De plus, l’organisation de sessions informelles pour les groupes de travail permet de prendre du recul sur les travaux en cours et de réfléchir tous ensemble, au-delà des dossiers concrets, à nos cadres et méthodes de travail.
V. D. : Travailler en amont à son organisation et vivre pendant six mois au rythme d’une présidence, avec tous les échanges informels qu’elle implique, permet d’aborder les sujets autrement ou en aborder de nouveaux. Cela ouvre la réflexion. De plus, l’organisation de sessions informelles pour les groupes de travail permet de prendre du recul sur les travaux en cours et de réfléchir tous ensemble, au-delà des dossiers concrets, à nos cadres et méthodes de travail.
Pourquoi avoir pris l’initiative d’organiser une conférence sur les données en vie réelle (real world evidence, RWE) au cours du cycle de vie du médicament ?
V. D. : Explorer ce sujet des données en vie réelle (RWE), c’est comprendre que les patients ayant aujourd’hui accès à des innovations de manière plus précoce qu’auparavant, le recueil d’un maximum de données en vie réelle devient essentiel pour vérifier leurs bénéfices. C’est aussi réaliser que le raisonnement statistique n’est pas suffisant pour répondre au besoin de plus en plus fort de prendre en compte chaque patient, dans toutes ses particularités. Enfin, c’est anticiper l’impact majeur de ces données sur notre métier pour imaginer de nouvelles méthodes d’évaluation.
P. D. : Ce sujet des données en vie réelle prend une importance croissante à l’heure où des découvertes scientifiques identifient des mécanismes pathologiques de plus en plus précis, et où de nombreux traitements dédiés à des cibles extrêmement pointues sont développés. La personnalisation rend plus difficile la réalisation d’essais cliniques et plus nécessaire la vérification de leur efficacité comparée aux données en vie réelle. Ces données peuvent aussi permettre en amont d’innover, si de nouvelles techniques d’essai sont créées. Enfin, l’analyse de ces données est précieuse pour confirmer, à plus long terme, l’efficacité réelle d’un médicament. Aujourd’hui, ces données sont disponibles. C’est une occasion inédite de mettre plus rapidement à la disposition des patients de vraies solutions encore plus fiables. Nous sommes convaincus qu’il serait inconscient, voire irresponsable de s’en priver. C’est pourquoi nous avons choisi ce sujet ; sujet d’ailleurs plébiscité par tous vu le succès de cette conférence.
P. D. : Ce sujet des données en vie réelle prend une importance croissante à l’heure où des découvertes scientifiques identifient des mécanismes pathologiques de plus en plus précis, et où de nombreux traitements dédiés à des cibles extrêmement pointues sont développés. La personnalisation rend plus difficile la réalisation d’essais cliniques et plus nécessaire la vérification de leur efficacité comparée aux données en vie réelle. Ces données peuvent aussi permettre en amont d’innover, si de nouvelles techniques d’essai sont créées. Enfin, l’analyse de ces données est précieuse pour confirmer, à plus long terme, l’efficacité réelle d’un médicament. Aujourd’hui, ces données sont disponibles. C’est une occasion inédite de mettre plus rapidement à la disposition des patients de vraies solutions encore plus fiables. Nous sommes convaincus qu’il serait inconscient, voire irresponsable de s’en priver. C’est pourquoi nous avons choisi ce sujet ; sujet d’ailleurs plébiscité par tous vu le succès de cette conférence.
Quel est, pour vous, le bilan de la présidence de l’ANSM ?
P. D. : La forte participation, la qualité des contributions, l’intérêt suscité et la satisfaction des participants témoignent du succès de cette présidence. Sur le fond, elle a illustré notre expertise et notre contribution majeure à l’avancée de la santé en Europe. Sur la forme, notre hospitalité a été saluée ainsi que, il faut saluer pour cela les équipes organisatrices, notre capacité à l’agilité dans des conditions difficiles ; le Covid nous a obligés à nous adapter au fil de l’eau entre distanciel et présentiel.
V. D. : Les 20 réunions que nous avons organisées – détaillées dans le temps fort ci-dessous – ont permis d’avancer collectivement sur des sujets majeurs et d’amorcer des discussions, tant formelles qu’informelles, qui se prolongeront lors des prochaines présidences, dans une approche transversale et pluridisciplinaire.
V. D. : Les 20 réunions que nous avons organisées – détaillées dans le temps fort ci-dessous – ont permis d’avancer collectivement sur des sujets majeurs et d’amorcer des discussions, tant formelles qu’informelles, qui se prolongeront lors des prochaines présidences, dans une approche transversale et pluridisciplinaire.
Plus largement, au-delà de l’Europe, quelle est la place de l’ANSM à l’international ?
V. D. : Compte tenu de nos ressources limitées, nous avons choisi de concentrer notre action en priorité dans le cadre des relations entre l’Europe et ses homologues à l’international. Nous sommes notamment très impliqués dans l’International Coalition of Medecine Regulation Agency (ICMRA), présidée par l’EMA, qui réunit toutes les agences de régulation mondiales. A l’initiative de cette coalition, nous y travaillons aujourd’hui avec les Japonais sur l’un de nos objectifs majeurs : l’innovation. Lorsque nous nous engageons dans une coopération bilatérale, c’est le plus souvent en réponse à un appel à projets de la Commission européenne, comme par exemple au Rwanda.
Focus sur le Rwanda : En quoi consistent le projet et notre intervention ?
V. D. : Nous avons répondu un consortium d’États européens à l’appel de la Commission européenne car cela nous permet, tout en aidant une agence africaine à se structurer, de travailler avec nos collègues européens et de favoriser l’émergence de l’Agence africaine du médicament (AMA) qui sera mise en place grâce aux agences africaines qui se seront elles-mêmes développées. L’AMA sera le pendant de l’EMA et leurs relations seront essentielles pour aller de l’avant sur les sujets de régulation des produits de santé. Les pays africains ont d’ailleurs décidé que l’AMA se trouvera au Rwanda comme l’EMA se trouve aux Pays-Bas.
Le jumelage que nous conduisons avec le Rwanda vise à accompagner, à ce stade, le développement de leur agence nationale. L’objectif est qu’elle atteigne le niveau 3 OMS (sur quatre niveaux) et devienne opérationnelle, pour tous les produits de santé, sur toutes les missions de régulation : autoriser les mises sur le marché, conduire des essais cliniques, inspecter et contrôler, surveiller les effets indésirables, etc. Sous la coordination d’Expertise France, nous contribuons à ce projet en collaboration avec l’Allemagne, la Belgique et la Lituanie, auxquels s’ajoute une participation de l’Autriche, de la Grèce et de la Suède. Notre mission a démarré fin 2022 et se déroulera sur 2 ans. L’ANSM pilote deux composantes phares du projet : la structuration, la stratégie, l’organisation et les procédures de l’agence d’une part ; la pharmacovigilance et le contrôle d’autre part. Nous accompagnons ainsi l’Afrique dans sa montée en capacité de produire et de réguler les produits de santé, y compris des vaccins.
Le jumelage que nous conduisons avec le Rwanda vise à accompagner, à ce stade, le développement de leur agence nationale. L’objectif est qu’elle atteigne le niveau 3 OMS (sur quatre niveaux) et devienne opérationnelle, pour tous les produits de santé, sur toutes les missions de régulation : autoriser les mises sur le marché, conduire des essais cliniques, inspecter et contrôler, surveiller les effets indésirables, etc. Sous la coordination d’Expertise France, nous contribuons à ce projet en collaboration avec l’Allemagne, la Belgique et la Lituanie, auxquels s’ajoute une participation de l’Autriche, de la Grèce et de la Suède. Notre mission a démarré fin 2022 et se déroulera sur 2 ans. L’ANSM pilote deux composantes phares du projet : la structuration, la stratégie, l’organisation et les procédures de l’agence d’une part ; la pharmacovigilance et le contrôle d’autre part. Nous accompagnons ainsi l’Afrique dans sa montée en capacité de produire et de réguler les produits de santé, y compris des vaccins.
Un mot pour conclure ?
P. D. : La France a retrouvé toute sa place. Grâce aux moyens obtenus, nous sommes à nouveau des acteurs essentiels de la régulation à l’échelle européenne.
V. D. : Cette forte implication est indispensable compte tenu des expertises et de l’ampleur des investissements nécessaires pour innover. Le plan français « santé 2030 » ne peut être conduit efficacement qu’en travaillant avec nos partenaires européens puisque les autorisations pour des produits innovants passent aujourd’hui obligatoirement par l’Europe. C’est le partage collégial des connaissances et des compétences communes qui nous permettra d’aller plus loin, au bénéfice de tous.
V. D. : Cette forte implication est indispensable compte tenu des expertises et de l’ampleur des investissements nécessaires pour innover. Le plan français « santé 2030 » ne peut être conduit efficacement qu’en travaillant avec nos partenaires européens puisque les autorisations pour des produits innovants passent aujourd’hui obligatoirement par l’Europe. C’est le partage collégial des connaissances et des compétences communes qui nous permettra d’aller plus loin, au bénéfice de tous.
Croiser les regards des pharmaciens et des médecins sur les produits de santé : naissance d'un réseau des correspondants
L’ANSM, le Collège de la médecine générale (CMG), la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) se sont associés pour créer un dispositif inédit de « réseau des correspondants », constitué de binômes de médecins généralistes et de pharmaciens d’officine exerçant partout en France.
L’objectif est d’enrichir les réflexions de l’ANSM de ces expériences terrain, en amont ou une fois prises une décision ou des mesures de sécurisation de l’utilisation de produits de santé. Les binômes peuvent également faire remonter des problématiques, des idées ou des initiatives issues de leur quotidien.
Sollicité au travers de courtes enquêtes dont le thème et les questions sont décidés en concertation entre les quatre partenaires, le réseau permet de mieux connaître et prendre en compte les pratiques, les attentes et les éventuelles difficultés rencontrées par ces professionnels et leurs patients.
Les enquêtes « flash » auxquelles les correspondants sont amenés à répondre portent sur des médicaments, des dispositifs médicaux, voire des thématiques de nature réglementaire, dans l’objectif de contribuer à l’amélioration du bon usage de ces produits.
Ce réseau des correspondants, qui repose sur un partenariat entre la FSPF, l’USPO, le CMG et l’ANSM, s’est naturellement structuré en binômes médecin généraliste-pharmacien d’officine répartis dans toute la France, y compris les régions d’outremer. Ainsi, les correspondants représentent la médecine et la pharmacie des villes et des zones rurales.
« C’est important que l’ANSM s’investisse au cœur des territoires, au plus près des patients et des professionnels de santé, en leur donnant la parole. Grâce à ce réseau, nous allons mieux appréhender les questionnements des médecins et des pharmaciens, la vision de chacun, nous enrichir mutuellement de nos pratiques et adapter les mesures au terrain afin de mieux sécuriser l’utilisation des produits de santé », souligne Pierre-Olivier Variot, président de l’USPO.
Le médecin généraliste et le pharmacien d’officine sont des professionnels de santé de proximité et de confiance pour les patients. Par le recueil de leurs points de vue croisés et, indirectement, de celui des patients qu’ils accompagnent au quotidien, le réseau des correspondants permet de prendre la température du terrain à propos des décisions de l’Agence visant à favoriser le bon usage des produits de santé. Pour Paul Frappé, président du CMG, « s’appuyer sur des binômes médecin généraliste-pharmacien d’officine pour pouvoir observer des deux côtés la même ordonnance, le même patient, le même questionnement est inédit et utile pour nos métiers et nos patients. ».
Pour sa phase pilote lors de cette première année, le « réseau des correspondants » se compose de 100 correspondants, soit 50 binômes de médecins et de pharmaciens qui se sont choisis mutuellement.
Philippe Besset, président de la FSPF, espère « qu’à l’issue de cette phase pilote prometteuse, ce dispositif inédit va se développer, notamment en termes de nombre de binômes mobilisés pour toujours plus de représentativité ».
Ce réseau des correspondants s'inscrit dans la stratégie d'ouverture engagée par l'ANSM depuis plusieurs années. C’est un levier complémentaire aux dispositifs existants que sont notamment les comités scientifiques permanents et les comités d’interface.
« Le réseau des correspondants illustre une devise qui me tient à cœur : "Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin". Sa création marque une nouvelle étape pour notre Agence qui s’inscrit ainsi toujours plus au cœur de la vie de nos concitoyens », conclut Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’ANSM.
L’objectif est d’enrichir les réflexions de l’ANSM de ces expériences terrain, en amont ou une fois prises une décision ou des mesures de sécurisation de l’utilisation de produits de santé. Les binômes peuvent également faire remonter des problématiques, des idées ou des initiatives issues de leur quotidien.
Sollicité au travers de courtes enquêtes dont le thème et les questions sont décidés en concertation entre les quatre partenaires, le réseau permet de mieux connaître et prendre en compte les pratiques, les attentes et les éventuelles difficultés rencontrées par ces professionnels et leurs patients.
Les enquêtes « flash » auxquelles les correspondants sont amenés à répondre portent sur des médicaments, des dispositifs médicaux, voire des thématiques de nature réglementaire, dans l’objectif de contribuer à l’amélioration du bon usage de ces produits.
Ce réseau des correspondants, qui repose sur un partenariat entre la FSPF, l’USPO, le CMG et l’ANSM, s’est naturellement structuré en binômes médecin généraliste-pharmacien d’officine répartis dans toute la France, y compris les régions d’outremer. Ainsi, les correspondants représentent la médecine et la pharmacie des villes et des zones rurales.
« C’est important que l’ANSM s’investisse au cœur des territoires, au plus près des patients et des professionnels de santé, en leur donnant la parole. Grâce à ce réseau, nous allons mieux appréhender les questionnements des médecins et des pharmaciens, la vision de chacun, nous enrichir mutuellement de nos pratiques et adapter les mesures au terrain afin de mieux sécuriser l’utilisation des produits de santé », souligne Pierre-Olivier Variot, président de l’USPO.
Le médecin généraliste et le pharmacien d’officine sont des professionnels de santé de proximité et de confiance pour les patients. Par le recueil de leurs points de vue croisés et, indirectement, de celui des patients qu’ils accompagnent au quotidien, le réseau des correspondants permet de prendre la température du terrain à propos des décisions de l’Agence visant à favoriser le bon usage des produits de santé. Pour Paul Frappé, président du CMG, « s’appuyer sur des binômes médecin généraliste-pharmacien d’officine pour pouvoir observer des deux côtés la même ordonnance, le même patient, le même questionnement est inédit et utile pour nos métiers et nos patients. ».
Pour sa phase pilote lors de cette première année, le « réseau des correspondants » se compose de 100 correspondants, soit 50 binômes de médecins et de pharmaciens qui se sont choisis mutuellement.
Philippe Besset, président de la FSPF, espère « qu’à l’issue de cette phase pilote prometteuse, ce dispositif inédit va se développer, notamment en termes de nombre de binômes mobilisés pour toujours plus de représentativité ».
Ce réseau des correspondants s'inscrit dans la stratégie d'ouverture engagée par l'ANSM depuis plusieurs années. C’est un levier complémentaire aux dispositifs existants que sont notamment les comités scientifiques permanents et les comités d’interface.
« Le réseau des correspondants illustre une devise qui me tient à cœur : "Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin". Sa création marque une nouvelle étape pour notre Agence qui s’inscrit ainsi toujours plus au cœur de la vie de nos concitoyens », conclut Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’ANSM.
Toujours plus engagée avec les associations de patients et d'usagers, l'ANSM renouvelle son comité d'interface
L’Agence a réuni le 9 septembre 2022 son nouveau comité d’interface avec les associations de patients et d’usagers du système de santé. Créé en 2013, ce comité a été renouvelé afin de consolider les liens noués entre les patients et l’Agence. Sa mission : favoriser les réflexions stratégiques et transversales sur des sujets d’intérêt communs et intégrer dans ses travaux la voix des patients et des usagers de santé. Ces derniers sont également présents depuis 2019 dans les comités scientifiques permanents (CSP) et temporaires (CST), participant ainsi aux discussions et aux décisions de l’ANSM sur les médicaments et les produits de santé.
France Assos santé (FAS), acteur majeur de la représentation des patients et des usagers, participe activement à la coordination et à l’animation du comité, avec l’ANSM.
Les membres du comité d’interface sont nommés pour 4 ans. Comme le rappelle Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’Agence : « Notre préoccupation première, au cœur de nos actions chaque jour, est la sécurité des patients. Depuis sa création en 2011, l’ANSM évolue pour répondre aux attentes de la société et s’est transformée jusque dans son organisation et sa gouvernance pour toujours mieux intégrer la voix des patients. Je suis profondément attachée à cette dynamique et je remercie chaque membre de ce comité ».
À l’écoute des patients et des usagers, l’Agence est définitivement engagée dans un dialogue permanent pour être au plus proche de leurs préoccupations et de leur vécu afin notamment d’élaborer ensemble des projets qui contribuent au principe majeur de démocratie sanitaire.
« Ce comité d’interface est un espace de co-construction et de dialogue visant à dynamiser la participation des associations et à défendre l’intérêt de tous les usagers ainsi que les victimes d’aléas thérapeutiques. France Assos Santé jouera toute sa place pour élaborer des propositions associatives et donner un nouvel élan à la démocratie en santé », assure Gérard Raymond, président de France Assos santé (FAS).
France Assos santé (FAS), acteur majeur de la représentation des patients et des usagers, participe activement à la coordination et à l’animation du comité, avec l’ANSM.
Les membres du comité d’interface sont nommés pour 4 ans. Comme le rappelle Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’Agence : « Notre préoccupation première, au cœur de nos actions chaque jour, est la sécurité des patients. Depuis sa création en 2011, l’ANSM évolue pour répondre aux attentes de la société et s’est transformée jusque dans son organisation et sa gouvernance pour toujours mieux intégrer la voix des patients. Je suis profondément attachée à cette dynamique et je remercie chaque membre de ce comité ».
À l’écoute des patients et des usagers, l’Agence est définitivement engagée dans un dialogue permanent pour être au plus proche de leurs préoccupations et de leur vécu afin notamment d’élaborer ensemble des projets qui contribuent au principe majeur de démocratie sanitaire.
« Ce comité d’interface est un espace de co-construction et de dialogue visant à dynamiser la participation des associations et à défendre l’intérêt de tous les usagers ainsi que les victimes d’aléas thérapeutiques. France Assos Santé jouera toute sa place pour élaborer des propositions associatives et donner un nouvel élan à la démocratie en santé », assure Gérard Raymond, président de France Assos santé (FAS).
Présidence française du Conseil de l’Union européenne : l'ANSM organise 20 réunions de groupes de travail et comités européens
Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France a présidé le Conseil de l’Union européenne (UE). Pendant ces six mois, elle a été en charge d’organiser et de gouverner, par domaine d’activité, l’ensemble des réunions du Conseil de l’UE.
Dans le cadre de cet événement exceptionnel, l’ANSM a organisé 20 réunions de groupes de travail et de comités européens : sept sont des réunions informelles des différents comités de l’EMA, neuf des groupes de travail du réseau HMA et trois relèvent du réseau CAMD. La vingtième réunion, qui s’est tenue à l’initiative de l’ANSM, a pris la forme d’une conférence entièrement consacrée aux données en vie réelle tout au long du cycle de vie du médicament.
Dans le cadre de cet événement exceptionnel, l’ANSM a organisé 20 réunions de groupes de travail et de comités européens : sept sont des réunions informelles des différents comités de l’EMA, neuf des groupes de travail du réseau HMA et trois relèvent du réseau CAMD. La vingtième réunion, qui s’est tenue à l’initiative de l’ANSM, a pris la forme d’une conférence entièrement consacrée aux données en vie réelle tout au long du cycle de vie du médicament.
Chiffres clés
- 94 réunions des comités scientifiques permanents
- 1 309 DPI contrôlées
- 1 586 contributions et analyses déontologiques
- 135 actualités et 4 communiqués de presse publiés
- 4 209 711 visiteurs uniques sur le site de l’ANSM
- 99 216 abonnés LinkedIn et 42 510 abonnés Twitter
- 12 webinaires d’information et d’échanges avec les professionnels de santé, les associations de patients et les exploitants et industriels
- 8 873 sollicitations du service d’accueil des usagers
Découvrez ci-dessous l'intégralité de la partie "Agir en toute transparence par le dialogue et l'ouverture "
En téléchargeant les sous-parties de votre choix :- Concertation et pluridisciplinarité : les travaux de nos instances consultatives
- Indépendance et impartialité : nos obligations déontologiques
- Dialogue et partage de l'information avec nos parties prenantes
- Une agence à l'écoute de ses usagers
- Une mise à disposition proactive et progressive de nos données
- Une forte activité juridique et réglementaire
- Une implication renforcée dans les travaux européens et internationaux