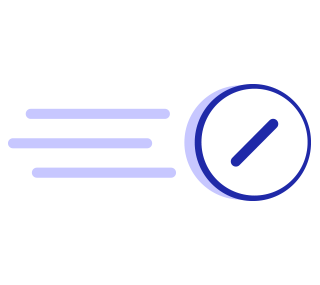Assurer la sécurité des patients exposés aux médicaments et produits de santé
Tout produit de santé présente des bénéfices mais également des risques : on parle alors de “balance bénéfice-risque”. Notre rôle consiste à nous assurer que cette balance est et reste positive, c’est-à-dire que les bénéfices pour le patient sont supérieurs aux risques encourus. Cette notion est fondamentale dans l’évaluation de l’efficacité et de la sécurité d’un produit de santé tout au long de son cycle de vie : en premier lieu au cours de son développement, puis une fois qu’il a été autorisé et mis sur le marché, à intervalles réguliers. Nous exerçons ainsi une surveillance constante des produits de santé.
Réponses avec Dominique Masset, coordonnateur reproduction grossesse allaitement, Dahlia Saccal-Diab, référente usage non conforme, et Philippe Vella, directeur médical.
Regards sur.. Politique de santé publique sur la prévention du mésusage : mobilisation à tous les étages
Avec le déploiement d’une politique de santé publique (PSP) sur le mésusage des médicaments et la création d’une cartographie inédite des classes à risques de mésusage, l’ANSM franchit une nouvelle étape. La lutte contre ce phénomène croissant prend de l’ampleur avec l’objectif d’une plus grande compréhension des risques pour mieux les réduire. Pourquoi un engagement aussi marqué ? Comment se traduit-il en actions ?Réponses avec Dominique Masset, coordonnateur reproduction grossesse allaitement, Dahlia Saccal-Diab, référente usage non conforme, et Philippe Vella, directeur médical.

Dominique Masset
Coordonnateur reproduction grossesse allaitement de l’ANSM

Dahlia Saccal-Diab
Référente usage non conforme de l’ANSM

Philippe Vella
Directeur médical de l'ANSM
Qu’est-ce que le mésusage et pourquoi l’ANSM a-t-elle initié une politique qui vise à le réduire ?
Dahlia Saccal-Diab : Si l’on devait le définir au sens qu’il a pour l’ANSM, le mésusage correspond à une utilisation d’un médicament dans un but médical, non conforme à la preuve scientifique, de manière intentionnelle mais inappropriée. Ce mésusage est susceptible d’entraîner pour les patients des effets indésirables qui peuvent être graves et durables.
Parmi les exemples les plus courants de mésusage figurent la prescription des antibiotiques dans les angines virales, le recours au paracétamol avec une posologie supérieure à celle prévue dans le RCP ou la notice, ou encore le renouvellement systématique des traitements à base de benzodiazépine sans réévaluation appropriée de leur pertinence.
Philippe Vella : Le mésusage concerne toutes les catégories de patients, et il est plus particulièrement sensible, c’est-à-dire à préjudiciable, lorsqu’il implique les populations les plus vulnérables : personnes âgées, en particulier polymédiquées, femmes enceintes ou enfants. Tous les médicaments comportent un risque de mésusage qui peut survenir à toutes les étapes de la chaîne de soin – prescription, délivrance, administration, utilisation. Il peut s’observer à un ou plusieurs temps de l’utilisation d’un médicament : indication, posologie, schéma d’administration, durée du traitement, contre-indications... Il recouvre aussi la problématique de la surprescription.
Plus l’accès au médicament est simple et facile – comme c’est le cas en France –, plus il est nécessaire de sécuriser son utilisation et de provoquer une prise de conscience pour éviter les dérives. Le médicament ne devrait pas être considéré comme un bien de consommation courante. Notre engagement renforcé sur ce sujet vise à fédérer et à sensibiliser plus fortement encore tous les acteurs de la chaîne de soin. L’objectif de cette politique de santé publique est de faire bouger les lignes.
D. S-D. : Évidemment, nous n’avons pas attendu une politique de santé dédiée pour initier notre réflexion et mettre en place des actions de prévention du mésusage des médicaments. En effet, acteur majeur de la sécurité d’emploi des produits de santé en France, l’Agence a toujours pris des mesures pour réduire les risques liés à certaines situations de mésusage, au cas par cas, via les outils réglementaires à sa disposition. À titre d’exemple, nous pouvons citer l’adaptation de la taille de conditionnement d’un médicament à sa durée du traitement, l’adaptation des conditions de prescription et de délivrance, ou encore la mise en place d’une carte patient pour informer sur la sécurité d’emploi d’un médicament et ainsi favoriser son bon usage. Mais au cours des dernières années, le constat d’une utilisation inappropriée de nombreux médicaments et classes thérapeutiques a transformé cette problématique en enjeu de santé publique. Cette situation nous a conduits à mettre en place une politique volontariste, large, dédiée à la prévention du mésusage et engageant l’ensemble des acteurs, qu’ils soient prescripteurs, pharmaciens, patients ou aidants. L’objectif de cette politique est d’agir en amont pour favoriser la prévention, la sensibilisation au bon usage des médicaments, et ainsi réduire les risques de mésusage et améliorer la sécurité des patients.
Parmi les exemples les plus courants de mésusage figurent la prescription des antibiotiques dans les angines virales, le recours au paracétamol avec une posologie supérieure à celle prévue dans le RCP ou la notice, ou encore le renouvellement systématique des traitements à base de benzodiazépine sans réévaluation appropriée de leur pertinence.
Philippe Vella : Le mésusage concerne toutes les catégories de patients, et il est plus particulièrement sensible, c’est-à-dire à préjudiciable, lorsqu’il implique les populations les plus vulnérables : personnes âgées, en particulier polymédiquées, femmes enceintes ou enfants. Tous les médicaments comportent un risque de mésusage qui peut survenir à toutes les étapes de la chaîne de soin – prescription, délivrance, administration, utilisation. Il peut s’observer à un ou plusieurs temps de l’utilisation d’un médicament : indication, posologie, schéma d’administration, durée du traitement, contre-indications... Il recouvre aussi la problématique de la surprescription.
Plus l’accès au médicament est simple et facile – comme c’est le cas en France –, plus il est nécessaire de sécuriser son utilisation et de provoquer une prise de conscience pour éviter les dérives. Le médicament ne devrait pas être considéré comme un bien de consommation courante. Notre engagement renforcé sur ce sujet vise à fédérer et à sensibiliser plus fortement encore tous les acteurs de la chaîne de soin. L’objectif de cette politique de santé publique est de faire bouger les lignes.
D. S-D. : Évidemment, nous n’avons pas attendu une politique de santé dédiée pour initier notre réflexion et mettre en place des actions de prévention du mésusage des médicaments. En effet, acteur majeur de la sécurité d’emploi des produits de santé en France, l’Agence a toujours pris des mesures pour réduire les risques liés à certaines situations de mésusage, au cas par cas, via les outils réglementaires à sa disposition. À titre d’exemple, nous pouvons citer l’adaptation de la taille de conditionnement d’un médicament à sa durée du traitement, l’adaptation des conditions de prescription et de délivrance, ou encore la mise en place d’une carte patient pour informer sur la sécurité d’emploi d’un médicament et ainsi favoriser son bon usage. Mais au cours des dernières années, le constat d’une utilisation inappropriée de nombreux médicaments et classes thérapeutiques a transformé cette problématique en enjeu de santé publique. Cette situation nous a conduits à mettre en place une politique volontariste, large, dédiée à la prévention du mésusage et engageant l’ensemble des acteurs, qu’ils soient prescripteurs, pharmaciens, patients ou aidants. L’objectif de cette politique est d’agir en amont pour favoriser la prévention, la sensibilisation au bon usage des médicaments, et ainsi réduire les risques de mésusage et améliorer la sécurité des patients.
En quoi consiste cette politique de santé publique sur la prévention du mésusage et comment se traduit-elle concrètement en actions ?
P. V. : Trois axes prioritaires de prévention des risques ont été définis : anticipation, pédagogie et information. Ils se déclinent ensuite en plans d’action.
D. S-D. : Pour l’axe anticipation, l’identification des classes de médicament les plus à risque de mésusage a été développée, afin de prioriser les mesures de prévention appropriées. En 2022, nous avons publié la méthodologie qui a été appliquée dans la mise au point de notre toute première cartographie des molécules les plus à risque de mésusage. Les axes pédagogie et information, eux, visent à sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés, à tous les niveaux de notre société, aux conséquences du mésusage des médicaments, pour favoriser leur bon usage.
En termes de pédagogie, l’Agence intervient de plus en plus dans des programmes de formation initiale et continue pour les professionnels de santé. Nous prévoyons également de sensibiliser progressivement les futurs professionnels de santé sur le mésusage, dans le cadre du service sanitaire, afin qu’ils puissent à leur tour porter ces messages de prévention auprès des jeunes publics. Enfin, sur l’axe information, 2023 sera une année importante pour l’ANSM : après l’avoir préparée tout au long de cette année en concertation avec nos parties prenantes, nous lancerons la première phase d’une campagne de promotion du bon usage des médicaments.
D. S-D. : Pour l’axe anticipation, l’identification des classes de médicament les plus à risque de mésusage a été développée, afin de prioriser les mesures de prévention appropriées. En 2022, nous avons publié la méthodologie qui a été appliquée dans la mise au point de notre toute première cartographie des molécules les plus à risque de mésusage. Les axes pédagogie et information, eux, visent à sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés, à tous les niveaux de notre société, aux conséquences du mésusage des médicaments, pour favoriser leur bon usage.
En termes de pédagogie, l’Agence intervient de plus en plus dans des programmes de formation initiale et continue pour les professionnels de santé. Nous prévoyons également de sensibiliser progressivement les futurs professionnels de santé sur le mésusage, dans le cadre du service sanitaire, afin qu’ils puissent à leur tour porter ces messages de prévention auprès des jeunes publics. Enfin, sur l’axe information, 2023 sera une année importante pour l’ANSM : après l’avoir préparée tout au long de cette année en concertation avec nos parties prenantes, nous lancerons la première phase d’une campagne de promotion du bon usage des médicaments.
Pourquoi faut-il une priorisation des actions et pourquoi avoir créé une cartographie des risques ?
Dominique Masset : Pour anticiper et mettre en place des actions de prévention efficaces, prioriser est nécessaire : on ne peut pas tout faire, partout, en même temps. L’enjeu est de réduire le mésusage en commençant par limiter les risques les plus importants, touchant les populations les plus fragiles, et c’est dans cette optique que nous avons réalisé cette cartographie. Prioriser implique d’abord de capter au plus près les situations à risques, via des outils de collecte et d’analyse, en croisant données de recherche et de terrain. Pour y parvenir, nous sommes partis d’une revue bibliographique du mésusage pour connaitre les facteurs de risques, des remontées terrain des effets indésirables et des pratiques de mésusage. Nous avons ensuite distingué celles qui peuvent être bénéfiques. Nous avons également identifié toutes les causes pouvant provoquer des effets indésirables et intégré, en les pondérant, tous les critères qui peuvent accroître ce risque (durée, interaction médicamenteuse, population sensible, publicité, etc.).
Enfin, croisant toutes les données (les cas de mésusage de la base nationale de pharmacovigilance, le volume d’exposition à la substance, les visas de publicité, les conditions de prescription et délivrance et l’exposition à une population sensible) pour chaque molécule à risque de mésusage, nous avons calculé un score de risque haut, important, modéré, ou faible.
Ainsi, nous avons créé la première cartographie des risques de mésusage. Ce classement a confirmé d’une part un mésusage déjà observé et faisant l’objet de mesures de prévention et d’autre part, les molécules associées à un mésusage en augmentation afin de les associer de manière prioritaire à des mesures de prévention appropriées. Sans surprise, cette cartographie a identifié comme classes de médicaments les plus à risques de mésusage : les antalgiques simples ou combinés, les antiinflammatoires, les hypnotiques et les anticoagulants. Cette cartographie constitue désormais un guide précieux pour développer des plans d’action pour réduire ces risques.
Enfin, croisant toutes les données (les cas de mésusage de la base nationale de pharmacovigilance, le volume d’exposition à la substance, les visas de publicité, les conditions de prescription et délivrance et l’exposition à une population sensible) pour chaque molécule à risque de mésusage, nous avons calculé un score de risque haut, important, modéré, ou faible.
Ainsi, nous avons créé la première cartographie des risques de mésusage. Ce classement a confirmé d’une part un mésusage déjà observé et faisant l’objet de mesures de prévention et d’autre part, les molécules associées à un mésusage en augmentation afin de les associer de manière prioritaire à des mesures de prévention appropriées. Sans surprise, cette cartographie a identifié comme classes de médicaments les plus à risques de mésusage : les antalgiques simples ou combinés, les antiinflammatoires, les hypnotiques et les anticoagulants. Cette cartographie constitue désormais un guide précieux pour développer des plans d’action pour réduire ces risques.
Pourquoi avoir réalisé une enquête d’opinion dans le cadre de cette politique de santé publique et pourquoi la concertation de vos parties prenantes et la collaboration entre tous les acteurs est-elle indispensable pour prévenir le mésusage ?
D. S-D. : Si nous avons réalisé, en 2021, cette enquête d’opinion auprès d’usagers, de médecins et de pharmaciens d’officine, c’était pour disposer d’un état des lieux des pratiques et des interactions entre ces trois acteurs de la chaîne de soin. Notre objectif était de mieux comprendre les usages mais aussi les freins au bon usage pour ensuite identifier des leviers d’action.
Cette enquête illustre à quel point la dynamique collective et la mobilisation de chacun est indispensable dans la prévention du mésusage du médicament. La participation des professionnels de santé et des patients est donc cruciale et c’est bien avec eux que la politique de santé publique se construit.
Cette enquête illustre à quel point la dynamique collective et la mobilisation de chacun est indispensable dans la prévention du mésusage du médicament. La participation des professionnels de santé et des patients est donc cruciale et c’est bien avec eux que la politique de santé publique se construit.
Votre politique de santé publique de prévention du mésusage est entrée en phase opérationnelle en 2022. Quel impact attendez-vous à moyen terme de cette politique de santé publique ?
P. V. : Chaque médicament est associé à un rapport bénéfice risque favorable lorsqu’il est utilisé dans les conditions pour lesquelles il a été autorisé. Le bon usage des médicaments permet de conserver cette situation d’équilibre favorable au patient. En revanche, par un usage inapproprié, le patient est exposé ou s’expose à des risques connus « évitables » alors que le bénéfice n’est plus garanti (indication non autorisée par exemple), ou à des risques majorés (modification de la dose, de la durée de traitement…). Notre politique donne une trajectoire claire pour agir efficacement collectivement contre ces dérives et garantir le bon usage des médicaments.
D. M. : Grâce à la cartographie, nous disposons non seulement d’une vision du paysage du mésusage des médicaments en France à partir de données disponibles à l’Agence, mais aussi des éléments qui doivent conduire à prioriser sa prévention en fonction du niveau de risque observé. En fédérant toutes les parties prenantes, nous espérons réduire l’ensemble des impacts sur la santé : impact humain et aussi économique, dépendance, interaction ou surconsommation médicamenteuse, diminution de l’automédication, etc.
D. S-D. : Par la sensibilisation des professionnels de la santé et des patients sur les risques potentiels du mésusage des médicaments et par des mesures de prévention efficaces, nous voulons promouvoir une utilisation appropriée et responsable des médicaments.
D. M. : Grâce à la cartographie, nous disposons non seulement d’une vision du paysage du mésusage des médicaments en France à partir de données disponibles à l’Agence, mais aussi des éléments qui doivent conduire à prioriser sa prévention en fonction du niveau de risque observé. En fédérant toutes les parties prenantes, nous espérons réduire l’ensemble des impacts sur la santé : impact humain et aussi économique, dépendance, interaction ou surconsommation médicamenteuse, diminution de l’automédication, etc.
D. S-D. : Par la sensibilisation des professionnels de la santé et des patients sur les risques potentiels du mésusage des médicaments et par des mesures de prévention efficaces, nous voulons promouvoir une utilisation appropriée et responsable des médicaments.
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) : entrée en application du nouveau règlement européen
Le règlement européen 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro est entré en application le 26 mai 2022. Il s’agit d’une évolution importante pour renforcer la sécurité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dans l’intérêt des patients.
La réglementation européenne sur ces dispositifs a été renforcée dans plusieurs domaines :
Comme pour les dispositifs médicaux, la transparence des données est également accrue grâce à la base de données européenne Eudamed qui contiendra des informations détaillées au sujet des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro disponibles en Europe et permettra notamment de connaître les incidents déclarés ainsi que l’avancée des études de performance.
Pour accompagner la mise en place de ces changement structurels importants, la période de transition a été prolongée jusqu’en 2028.
La réglementation européenne sur ces dispositifs a été renforcée dans plusieurs domaines :
- Modification des règles de classifications avec l’instauration de classes de risque. L’impact de cette modification est que près de 80 à 90 % des DMDIV vont dorénavant appliquer des procédures de démonstration de conformité nécessitant l’intervention d’un organisme notifié ;
- Renforcement des exigences qui incombent aux industriels avant la commercialisation d’un DMDIV. Cela concerne notamment des exigences de démonstration de la performance clinique avec une accentuation de l’évaluation clinique de ces dispositifs, au bénéfice du patient. Il s’agit maintenant d’un passage obligé pour tout dispositif de diagnostic in vitro à risque ;
- Structuration du suivi clinique après commercialisation ;
- Mise en place d’un processus d’évaluation spécifique pour les DMDIV compagnons ;
- Mise à disposition de services par la technologie de l’information.
Comme pour les dispositifs médicaux, la transparence des données est également accrue grâce à la base de données européenne Eudamed qui contiendra des informations détaillées au sujet des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro disponibles en Europe et permettra notamment de connaître les incidents déclarés ainsi que l’avancée des études de performance.
Pour accompagner la mise en place de ces changement structurels importants, la période de transition a été prolongée jusqu’en 2028.
Epidémie de mpox : l’ANSM contribue à une stratégie vaccinale réactive
Des cas confirmés d’infection par le virus mpox (nouvelle nomenclature pour le virus Monkeypox) sans lien direct avec un voyage en Afrique centrale ou de l’Ouest (zone endémique) ou avec des personnes de retour de zone endémique ont été signalés en Europe et à l’international.
En France, les premiers cas d’infections mpox ont été confirmés mi-mai 2022 par le Centre national de référence des Orthopoxvirus et Santé publique France (SpF).
En Europe, ces cas sont survenus principalement, mais pas uniquement, chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), sans lien direct avec des personnes de retour de zone endémique.
Il s’agit de la première épidémie à virus mpox dans ces populations. Ce virus mpox est proche de celui de la variole mais beaucoup moins sévère. Le 23 juillet 2022, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a reconnu l’émergence de cette épidémie d’infections à virus mpox comme une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
L’ANSM a travaillé en étroite collaboration avec la Haute Autorité de Santé (HAS) et le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) suite à l’apparition des premiers cas d’infection mpox. Le HCSP a émis, le 24 mai 2022, un avis relatif à la conduite à tenir autour d’un cas suspect, probable ou confirmé d’infection au virus mpox. Cet avis a été actualisé le 8 juillet 2022. La HAS, dans son avis n° 2022.0034/SESPEV du 20 mai 2022, a initialement recommandé la mise en œuvre d’une stratégie vaccinale réactive en post-exposition avec les vaccins antivarioliques dits de « troisième génération » (Imvanex et Jynneos de la firme Bavarian Nordic). Cette indication a été ensuite complétée par une recommandation de vaccination préventive aux personnes les plus à risque d’exposition dans l’avis HAS n°2022.0039/AC/SESPEV du 7 juillet 2022. Plusieurs avis ont permis d’étendre la prévention aux personnes les plus à risque, au fur et à mesure des connaissances concernant cette épidémie (avis HAS n° 2022.0054/AC/SESPEV du 6 octobre 2022).
En effet, des vaccins (Imvanex de la firme Bavarian Nordic) disposaient d’une autorisation européenne sous circonstances exceptionnelles datant du 31 juillet 2013 dans l’indication contre la variole chez les adultes. L’utilisation d’Imvanex dans la prévention spécifique contre l’infection au virus mpox, a donc été autorisée en France par arrêté du ministère chargé de la santé le 25 mai 2022. L’Agence européenne du médicament (EMA) a par la suite étendu les indications du vaccin Imvanex : immunisation active contre la variole (virus Smallpox), la variole du singe (virus mpox) et la maladie causée par le virus de la vaccine (virus Vaccinia) chez les adultes.
En parallèle, des stocks du vaccin Jynneos ont été importés en France. Ce vaccin (de la même firme Bavarian Nordic et identique à Imvanex en termes d’efficacité et du profil de tolérance) avait obtenu une AMM aux États-Unis le 24 septembre 2019, à la fois dans la prévention de la variole et de la variole du singe (virus mpox). Au total plus de 142 000 doses de ces vaccins ont été administrées.
Les informations concernant l’accès à la vaccination sont rassemblées sur le site « Vaccination contre le Monkeypox (variole du singe) »
En parallèle, l’ANSM a facilité l’accès pour les patients qui avaient un besoin de traitements spécialisés (antiviraux dont Tecovirimat de la firme SIGA ou immunoglobulines spécifiques)
L’Agence a également mis en place une surveillance renforcée des effets indésirables avec les vaccins et traitements contre le virus mpox. A la date du 31/12/2022, aucun signal de sécurité n'a été mis en évidence (nombre de doses de vaccins administrées en 2022 = 142 072). Le suivi renforcé continue.
En France, les premiers cas d’infections mpox ont été confirmés mi-mai 2022 par le Centre national de référence des Orthopoxvirus et Santé publique France (SpF).
En Europe, ces cas sont survenus principalement, mais pas uniquement, chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), sans lien direct avec des personnes de retour de zone endémique.
Il s’agit de la première épidémie à virus mpox dans ces populations. Ce virus mpox est proche de celui de la variole mais beaucoup moins sévère. Le 23 juillet 2022, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a reconnu l’émergence de cette épidémie d’infections à virus mpox comme une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
L’ANSM a travaillé en étroite collaboration avec la Haute Autorité de Santé (HAS) et le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) suite à l’apparition des premiers cas d’infection mpox. Le HCSP a émis, le 24 mai 2022, un avis relatif à la conduite à tenir autour d’un cas suspect, probable ou confirmé d’infection au virus mpox. Cet avis a été actualisé le 8 juillet 2022. La HAS, dans son avis n° 2022.0034/SESPEV du 20 mai 2022, a initialement recommandé la mise en œuvre d’une stratégie vaccinale réactive en post-exposition avec les vaccins antivarioliques dits de « troisième génération » (Imvanex et Jynneos de la firme Bavarian Nordic). Cette indication a été ensuite complétée par une recommandation de vaccination préventive aux personnes les plus à risque d’exposition dans l’avis HAS n°2022.0039/AC/SESPEV du 7 juillet 2022. Plusieurs avis ont permis d’étendre la prévention aux personnes les plus à risque, au fur et à mesure des connaissances concernant cette épidémie (avis HAS n° 2022.0054/AC/SESPEV du 6 octobre 2022).
En effet, des vaccins (Imvanex de la firme Bavarian Nordic) disposaient d’une autorisation européenne sous circonstances exceptionnelles datant du 31 juillet 2013 dans l’indication contre la variole chez les adultes. L’utilisation d’Imvanex dans la prévention spécifique contre l’infection au virus mpox, a donc été autorisée en France par arrêté du ministère chargé de la santé le 25 mai 2022. L’Agence européenne du médicament (EMA) a par la suite étendu les indications du vaccin Imvanex : immunisation active contre la variole (virus Smallpox), la variole du singe (virus mpox) et la maladie causée par le virus de la vaccine (virus Vaccinia) chez les adultes.
En parallèle, des stocks du vaccin Jynneos ont été importés en France. Ce vaccin (de la même firme Bavarian Nordic et identique à Imvanex en termes d’efficacité et du profil de tolérance) avait obtenu une AMM aux États-Unis le 24 septembre 2019, à la fois dans la prévention de la variole et de la variole du singe (virus mpox). Au total plus de 142 000 doses de ces vaccins ont été administrées.
Les informations concernant l’accès à la vaccination sont rassemblées sur le site « Vaccination contre le Monkeypox (variole du singe) »
En parallèle, l’ANSM a facilité l’accès pour les patients qui avaient un besoin de traitements spécialisés (antiviraux dont Tecovirimat de la firme SIGA ou immunoglobulines spécifiques)
L’Agence a également mis en place une surveillance renforcée des effets indésirables avec les vaccins et traitements contre le virus mpox. A la date du 31/12/2022, aucun signal de sécurité n'a été mis en évidence (nombre de doses de vaccins administrées en 2022 = 142 072). Le suivi renforcé continue.
Amoxicilline : l'ANSM émet des recommandations pour contribuer à garantir la couverture des besoins des patients
L’épidémie de bronchiolite de l’automne 2022, à laquelle sont venues ensuite s’ajouter une nouvelle vague de Covid-19 et la grippe, a entrainé une forte augmentation de la demande des spécialités à base d’amoxicilline seule et associée, en particulier des formes pédiatriques buvables, augmentation qui n’avait pas été anticipée ni par son importance ni par sa précocité par les laboratoires. Les plannings de production des sites fournissant les États européens, situés respectivement en France, Allemagne et Autriche, qui fonctionnaient en sous-régime ces deux dernières années durant la pandémie de Covid-19 du fait d'une forte baisse de la demande, se sont avérés insuffisants et le délai nécessaire à la reprise d’une activité à hauteur des besoins n’a pas permis de couvrir les besoins immédiats.
Cette situation de tension pour cet antibiotique, qui est le plus couramment prescrit, a touché de façon plus ou moins importante l’ensemble des États européens et de nombreux pays hors Europe, comme l’a constaté l’Agence en prenant part aux travaux européens mis en œuvre dans ce contexte. Il est à noter que la France est le plus grand consommateur européen de cet antibiotique.
En réaction aux signalements successifs de tensions ou de ruptures de spécialités à base d'amoxicilline, l’ANSM a convoqué l'ensemble des laboratoires en octobre 2022 pour établir un état des lieux de la situation.
Une fiche Rupture de Stocks a été publiée rapidement afin de permettre l’interdiction des exportations aux grossistes répartiteurs (CSP L.514-17-3, L.5121-30).
L’Agence a demandé aux laboratoires d’optimiser la mobilisation des sites de production pour augmenter leur capacité de production, et dans l’attente, de rechercher des solutions à court terme, telles que des pistes d'importation de médicaments initialement destinés à d’autres pays d’Europe ou hors Europe.
Un suivi des consommations en officines, des stocks chez les laboratoires et les grossistes répartiteurs et des approvisionnements, ainsi que des points réguliers avec les laboratoires exploitants ont immédiatement été organisés.
En parallèle, afin de permettre une répartition des stocks la plus équitable possible sur le territoire national, les ventes directes des laboratoires aux officines ont été suspendues pour ne conserver que le circuit des grossistes-répartiteurs pour la ville. Le circuit hospitalier a quant à lui été préservé, ainsi que le circuit vers les territoires ultra-marins.
L’ANSM a échangé avec les parties prenantes dans la perspective de la diffusion d’informations sur la situation. Des points réguliers avec les pharmaciens et les grossistes répartiteurs, ainsi qu’un suivi de leurs états de stocks, ont permis de mesurer l’impact sur le terrain et d’ajuster le plan d’actions en conséquence et dans la mesure des possibilités.
L’Agence a publié en novembre 2022 des recommandations à destination des pharmaciens, des médecins, des patients et parents avec l’aide des sociétés savantes.
Ces recommandations portent sur les points suivants :
Un suivi des consommations, des stocks chez les laboratoires et des approvisionnements des alternatives s’est avéré nécessaire du fait de reports importants sur ces spécialités en l’absence d’amoxicilline. Des mesures ont été mises en place sur ces spécialités au cas par cas en fonction du niveau de tensions observées. En effet, certaines de ces alternatives, en particulier les formes pédiatriques, ont fait l’objet d’une forte augmentation de la demande et ont dû être contingentées pour éviter des ruptures sèches en l’absence de pistes d’importation, face à l’ampleur internationale de ces difficultés.
En complément, le 8 décembre 2022, le groupe de pathologie infectieuse de la Société française de pédiatrie, l'Association française de pédiatrie ambulatoire et la Société française de pathologie infectieuse de langue française, ont publié des propositions pour la préparation de forme buvables d’amoxicilline à partir d’autres formes d'amoxicilline lorsque la forme buvable était indisponible.
Ces propositions ont été relayées sur le site internet de l’ANSM.
Enfin, face à la persistance des difficultés pour répondre à toutes les demandes, l’ANSM a publié des recommandations et des monographies de fabrication ainsi que les notices d’utilisations de préparations magistrales. L’Agence a, dans ce cadre, animé un collectif d’officines volontaires spécialisés dans les préparations magistrales pour les enfants. Ceci afin de permettre aux pharmaciens de délivrer directement, à titre exceptionnel et temporaire, une préparation magistrale adaptée pour les enfants de moins de 12 ans si le médicament prescrit n'était pas disponible. Plus de 160 000 patients auront pu être traités grâce à ces préparations.
L’ANSM travaille à des mesures d’anticipation de la saison hivernale 2023-2024, afin d’éviter des difficultés analogues.
Cette situation de tension pour cet antibiotique, qui est le plus couramment prescrit, a touché de façon plus ou moins importante l’ensemble des États européens et de nombreux pays hors Europe, comme l’a constaté l’Agence en prenant part aux travaux européens mis en œuvre dans ce contexte. Il est à noter que la France est le plus grand consommateur européen de cet antibiotique.
En réaction aux signalements successifs de tensions ou de ruptures de spécialités à base d'amoxicilline, l’ANSM a convoqué l'ensemble des laboratoires en octobre 2022 pour établir un état des lieux de la situation.
Une fiche Rupture de Stocks a été publiée rapidement afin de permettre l’interdiction des exportations aux grossistes répartiteurs (CSP L.514-17-3, L.5121-30).
L’Agence a demandé aux laboratoires d’optimiser la mobilisation des sites de production pour augmenter leur capacité de production, et dans l’attente, de rechercher des solutions à court terme, telles que des pistes d'importation de médicaments initialement destinés à d’autres pays d’Europe ou hors Europe.
Un suivi des consommations en officines, des stocks chez les laboratoires et les grossistes répartiteurs et des approvisionnements, ainsi que des points réguliers avec les laboratoires exploitants ont immédiatement été organisés.
En parallèle, afin de permettre une répartition des stocks la plus équitable possible sur le territoire national, les ventes directes des laboratoires aux officines ont été suspendues pour ne conserver que le circuit des grossistes-répartiteurs pour la ville. Le circuit hospitalier a quant à lui été préservé, ainsi que le circuit vers les territoires ultra-marins.
L’ANSM a échangé avec les parties prenantes dans la perspective de la diffusion d’informations sur la situation. Des points réguliers avec les pharmaciens et les grossistes répartiteurs, ainsi qu’un suivi de leurs états de stocks, ont permis de mesurer l’impact sur le terrain et d’ajuster le plan d’actions en conséquence et dans la mesure des possibilités.
L’Agence a publié en novembre 2022 des recommandations à destination des pharmaciens, des médecins, des patients et parents avec l’aide des sociétés savantes.
Ces recommandations portent sur les points suivants :
- Rappel du bon usage des antibiotiques ;
- Utilisation des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) angine pour les patients avec des symptômes d’angine ;
- Dispensation, autant que possible, de ces antibiotiques dans des conditionnements adaptés à une durée de traitement de 5 jours recommandée dans la plupart des pathologies infectieuses courantes (angines bactériennes, otites, pneumonies…) ;
- Priorisation de la dispensation à l’unité des spécialités dès que cela était possible.
Un suivi des consommations, des stocks chez les laboratoires et des approvisionnements des alternatives s’est avéré nécessaire du fait de reports importants sur ces spécialités en l’absence d’amoxicilline. Des mesures ont été mises en place sur ces spécialités au cas par cas en fonction du niveau de tensions observées. En effet, certaines de ces alternatives, en particulier les formes pédiatriques, ont fait l’objet d’une forte augmentation de la demande et ont dû être contingentées pour éviter des ruptures sèches en l’absence de pistes d’importation, face à l’ampleur internationale de ces difficultés.
En complément, le 8 décembre 2022, le groupe de pathologie infectieuse de la Société française de pédiatrie, l'Association française de pédiatrie ambulatoire et la Société française de pathologie infectieuse de langue française, ont publié des propositions pour la préparation de forme buvables d’amoxicilline à partir d’autres formes d'amoxicilline lorsque la forme buvable était indisponible.
Ces propositions ont été relayées sur le site internet de l’ANSM.
Enfin, face à la persistance des difficultés pour répondre à toutes les demandes, l’ANSM a publié des recommandations et des monographies de fabrication ainsi que les notices d’utilisations de préparations magistrales. L’Agence a, dans ce cadre, animé un collectif d’officines volontaires spécialisés dans les préparations magistrales pour les enfants. Ceci afin de permettre aux pharmaciens de délivrer directement, à titre exceptionnel et temporaire, une préparation magistrale adaptée pour les enfants de moins de 12 ans si le médicament prescrit n'était pas disponible. Plus de 160 000 patients auront pu être traités grâce à ces préparations.
L’ANSM travaille à des mesures d’anticipation de la saison hivernale 2023-2024, afin d’éviter des difficultés analogues.
Paracétamol : l'ANSM se mobilise pour assurer la couverture des besoins des patients
Les spécialités à base de paracétamol (formes orales et suppositoires) ont fait l’objet de difficultés d’approvisionnement pendant plusieurs mois en 2022. Les formes injectables n’ont pas été impactées.
Cette situation, qui a particulièrement impacté la population pédiatrique, fait suite à des difficultés de production auxquelles s’est ajoutée une augmentation des consommations dans le contexte notamment de la 7e vague de Covid-19 et de la précocité / intensité des pathologies au cours de la saison automne / hiver.
En avril 2022, l’ANSM a été alertée par des remontées de terrain faisant état de ruptures d’approvisionnement en paracétamol. Un suivi des consommations, des stocks et des approvisionnements, ainsi que des points réguliers avec les laboratoires ont immédiatement été mis en place.
Une vigilance a également été mise en œuvre sur le risque de rupture en substance active qui pourrait survenir des suites des confinements décidés en Chine pour freiner l’épidémie de Covid-19. Les laboratoires ont diversifié leurs sources de matières premières et n’ont finalement pas été confrontés à ce type de difficulté.
Les plannings et capacités de production en médicament ont été optimisés. Des usines ont ainsi fonctionné 24h/24 et si possible 7j/7, et des sites alternatifs ont été mobilisés.
L’ANSM s’est assurée de la mise en œuvre par les laboratoires de contingentements quantitatifs de leurs livraisons aux officines et aux grossistes-répartiteurs, tout en sécurisant les approvisionnements des établissements de santé. Cette mesure a permis de répartir équitablement les approvisionnements sur l’ensemble du territoire et de préserver les stocks disponibles.
L’exportation de ces médicaments par les grossistes-répartiteurs a également été interdite.
Le 12 juillet 2022, l’ANSM, en coopération avec les syndicats de pharmaciens d’officine (FSPF et USPO), a publié un point de situation sur ces tensions et des recommandations à destination des pharmaciens d’officine et du grand public. Il est notamment demandé aux pharmaciens de limiter la dispensation à deux boîtes par patient sans ordonnance.
Après une période d’amélioration, la situation s’est à nouveau tendue à l’automne 2022, en particulier pour les formes pédiatriques, en raison de fortes augmentations des consommations, alors que les laboratoires n’avaient pas encore pu complètement reconstituer des stocks sécurisés, face à l’épidémie de bronchiolite, à laquelle sont venues ensuite s’ajouter une nouvelle vague de Covid-19 et la grippe.
En concertation avec les laboratoires, la production a été priorisée sur les présentations permettant de répondre aux besoins de toute la population quelle que soit son poids.
Afin de permettre une répartition la plus équitable possible sur le territoire national, les ventes directes des présentations pédiatriques des laboratoires vers les officines ont également été suspendues, seul le circuit grossistes-répartiteurs a été conservé. Le circuit hospitalier ainsi que les DROM ont quant à eux été préservés.
Le 19 octobre 2022, l’ANSM en collaboration avec la FSPF, l’USPO et le Collège de la Médecine Générale (CMG) ont à nouveau formulé des recommandations à l’attention des pharmaciens, des prescripteurs et des patients afin de modérer l’utilisation de paracétamol et permettre ainsi aux patients qui ont un besoin immédiat de pouvoir en bénéficier.
Tout au long de l’année, l’ANSM a échangé régulièrement avec les parties prenantes. Des points réguliers avec l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les associations de patients ont permis de suivre l’impact sur le terrain du plan d’actions et de l’ajuster en conséquence, dans la mesure des possibilités.
Pour en savoir plus :
Cette situation, qui a particulièrement impacté la population pédiatrique, fait suite à des difficultés de production auxquelles s’est ajoutée une augmentation des consommations dans le contexte notamment de la 7e vague de Covid-19 et de la précocité / intensité des pathologies au cours de la saison automne / hiver.
En avril 2022, l’ANSM a été alertée par des remontées de terrain faisant état de ruptures d’approvisionnement en paracétamol. Un suivi des consommations, des stocks et des approvisionnements, ainsi que des points réguliers avec les laboratoires ont immédiatement été mis en place.
Une vigilance a également été mise en œuvre sur le risque de rupture en substance active qui pourrait survenir des suites des confinements décidés en Chine pour freiner l’épidémie de Covid-19. Les laboratoires ont diversifié leurs sources de matières premières et n’ont finalement pas été confrontés à ce type de difficulté.
Les plannings et capacités de production en médicament ont été optimisés. Des usines ont ainsi fonctionné 24h/24 et si possible 7j/7, et des sites alternatifs ont été mobilisés.
L’ANSM s’est assurée de la mise en œuvre par les laboratoires de contingentements quantitatifs de leurs livraisons aux officines et aux grossistes-répartiteurs, tout en sécurisant les approvisionnements des établissements de santé. Cette mesure a permis de répartir équitablement les approvisionnements sur l’ensemble du territoire et de préserver les stocks disponibles.
L’exportation de ces médicaments par les grossistes-répartiteurs a également été interdite.
Le 12 juillet 2022, l’ANSM, en coopération avec les syndicats de pharmaciens d’officine (FSPF et USPO), a publié un point de situation sur ces tensions et des recommandations à destination des pharmaciens d’officine et du grand public. Il est notamment demandé aux pharmaciens de limiter la dispensation à deux boîtes par patient sans ordonnance.
Après une période d’amélioration, la situation s’est à nouveau tendue à l’automne 2022, en particulier pour les formes pédiatriques, en raison de fortes augmentations des consommations, alors que les laboratoires n’avaient pas encore pu complètement reconstituer des stocks sécurisés, face à l’épidémie de bronchiolite, à laquelle sont venues ensuite s’ajouter une nouvelle vague de Covid-19 et la grippe.
En concertation avec les laboratoires, la production a été priorisée sur les présentations permettant de répondre aux besoins de toute la population quelle que soit son poids.
Afin de permettre une répartition la plus équitable possible sur le territoire national, les ventes directes des présentations pédiatriques des laboratoires vers les officines ont également été suspendues, seul le circuit grossistes-répartiteurs a été conservé. Le circuit hospitalier ainsi que les DROM ont quant à eux été préservés.
Le 19 octobre 2022, l’ANSM en collaboration avec la FSPF, l’USPO et le Collège de la Médecine Générale (CMG) ont à nouveau formulé des recommandations à l’attention des pharmaciens, des prescripteurs et des patients afin de modérer l’utilisation de paracétamol et permettre ainsi aux patients qui ont un besoin immédiat de pouvoir en bénéficier.
Tout au long de l’année, l’ANSM a échangé régulièrement avec les parties prenantes. Des points réguliers avec l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les associations de patients ont permis de suivre l’impact sur le terrain du plan d’actions et de l’ajuster en conséquence, dans la mesure des possibilités.
Pour en savoir plus :
- Paracétamol : l’ANSM et les syndicats de pharmaciens mobilisés pour assurer la couverture des besoins
- Paracétamol : limiter les tensions d’approvisionnement qui se prolongent
- Tensions d'approvisionnement en paracétamol : l’ANSM publie la liste des médicaments pédiatriques à utiliser selon le poids de l’enfant
Chiffres clés
- 26 nouvelles SRE avec une moyenne de 43 SRE en cours
Médicaments
- 102 221 cas d’effets indésirables ont été recueillis, analysés et enregistrés par les CRPV dont 46 829 hors vaccins Covid-19 dans la base nationale de pharmacovigilance
- 41 467 cas d’effets indésirables ont été déclarés par les laboratoires pharmaceutiques dont 38 223 hors vaccins Covid-19
- 67 enquêtes de pharmacovigilance étaient en cours en 2022 avec 5 nouvelles enquêtes ouvertes
- France rapporteur de 146 dossiers inscrits aux ordres du jour du PRAC
- 6 314 notifications spontanées de cas d’abus, de pharmacodépendance et d’usage détourné ont été recueillies, analysées et enregistrées par les CEIP-A dans la base nationale de pharmacovigilance
- 30 enquêtes d’addictovigilance étaient en cours en 2022
- 1 926 signalements d’erreurs médicamenteuses ou de risques d’erreurs médicamenteuses rapportés à l’ANSM
- 3 761 signalements de ruptures de stock et de risque de ruptures ont été gérés par l’ANSM, avec recherche d’alternatives thérapeutiques pour les produits indispensables
- 1 890 signalements de défauts de qualité
Produits sanguins
- 6 850 effets indésirables ont été déclarés en hémovigilance chez des donneurs de produits sanguins labiles
- 7 899 effets indésirables ont été déclarés en hémovigilance chez des receveurs de produits sanguins labiles
Dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- 29 203 effets indésirables ont été déclarés en matériovigilance dont 1 451 reçus de patients et associations de patients
- 1 754 effets indésirables ont été déclarés en réactovigilance
Inspections et contrôles en laboratoire
- 562 inspections ont été réalisées dont :
- 8 % d’inspections inopinées,
- 4 % d’inspections réalisées à l’étranger
- 3 879 contrôles en laboratoire effectués
Découvrez ci-dessous l'intégralité de la partie "Assurer la sécurité des patients exposés aux médicaments et produits de santé"
En téléchargeant les sous-parties de votre choix :- Situations à risque élevé : 26 nouvelles en 2022
- La surveillance des médicaments
- La surveillance des produits sanguins
- La surveillance des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- La surveillance des autres produits de santé
- L'inspection pour veiller au respect de la qualité des pratiques et des produits de santé
- Le contrôle de la qualité des produits de santé en laboratoire